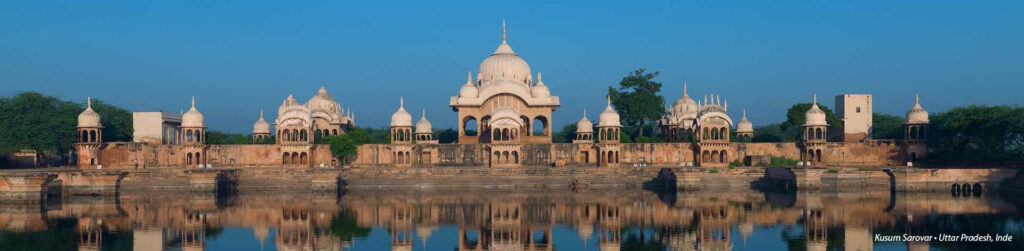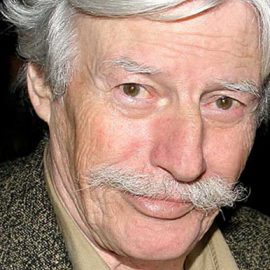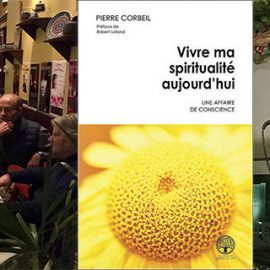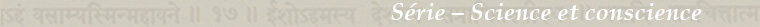

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Avec son œuvre maîtresse, visionnaire et révolutionnaire, le philosophe Gilbert Ryle semblait avoir exorcisé le spectre de la conscience, qu’il appelait «le fantôme dans la machine» en référence au dualisme corps-esprit de Descartes.
Noam Chomsky note toutefois que l’histoire de la science démontre exactement le contraire: la matière comme «machine» purement mécanique a été exorcisée alors que le «fantôme» de la conscience demeure. De sorte que c’est maintenant la nature de la matière, et non de la conscience, qui est remise en question! Chomsky renchérit en disant qu’il incombe donc à ceux qui persistent à croire que la conscience se réduit à un produit de la matière d’expliquer d’abord ce qu’est exactement la matière.
Dans The Matter Myth, les physiciens Paul Davies et John Gribbin arguent quant à eux que Ryle était justifié de rompre avec Descartes, mais pour la mauvaise raison: «pas parce qu’il n’y a pas de fantôme, mais parce qu’en fin de compte, il n’y a pas de machine».
Pour reprendre les mots du physicien Joseph Ford, le paradigme mécaniste matérialiste est un des «mythes fondateurs» de la physique classique. Il nous présente la réalité comme un simple amas de particules interagissant les unes avec les autres sans aucun dessein. Or, nous savons maintenant – la science postmécaniste ayant fait la lumière sur la question – que l’univers a intrinsèquement tendance à s’auto-organiser, ce qui sous-entend qu’il n’est pas sans dessein.
Repenser l’espace et le temps
La remise en question de la nature même de la matière et l’incapacité de la science actuelle à élucider la question de la conscience exigent une toute nouvelle approche à la science, pour ne pas dire une seconde révolution scientifique. Dans Particle Physics and Inflationary Cosmology, le physicien Andrei Linde de l’Université Stanford dépeint la situation comme suit:
«Avec l’évolution de la science, l’étude de l’univers et l’étude de la conscience ne deviendront-elles pas inséparables? Le réel progrès de l’une ne sera-t-il pas impossible sans réel progrès de l’autre? La prochaine étape importante ne tient-elle pas au développement d’une approche unifiée du monde dans sa globalité, inclusion faite du monde de la conscience?»
De fait, outre le problème que pose la conscience par rapport à notre entendement actuel du temps et de l’espace, d’autres préoccupations pressantes exigent une nouvelle approche à l’étude de la matière. La mécanique quantique appelle d’ailleurs une nouvelle conception de la matière si la physique aspire à devenir plus qu’un outil pratique ne sachant réaliser que des progrès technologiques.
Tous les physiciens quantiques d’envergure, y compris les pères fondateurs et les plus récents Nobel, se sont prononcés sur le fait qu’à l’heure actuelle, nous ne comprenons pas la réalité physique sous-jacente à la théorie quantique. C’est que, pour interpréter la théorie quantique d’une façon réaliste et compatible avec nos intuitions de sens commun, les modes de visualisation classiques et quasi classiques de l’espace-temps ne suffisent pas. Toutes les combinaisons d’idées convergeant dans ce sens ont été exploitées, et elles ne font qu’ajouter à la confusion générale. D’où le besoin incontournable d’une nouvelle compréhension du temps et de l’espace.
Repenser la matière
Ravi V. Gomatam propose précisément une nouvelle façon de comprendre la matière. Faisant référence au fameux argument de la Chambre chinoise de John Searle, il suggère de voir les objets de tous les jours comme des «symboles» objectifs constitués d’information sémantique ou de signification subjective plutôt que de matière classique, tenue pour n’être constituée que de propriétés primaires comme le poids, la masse, la longueur et autres. Gomatam qualifie sa conception de la matière d’«information sémantique objective».
Il explique que la physique classique conçoit les «choses» comme des manifestations ontologiques kantiennes dépourvues de sens qui ne peuvent être identifiées que par des propriétés quantitatives élémentaires. La physique quantique décrit plutôt les «choses» non seulement en fonction de leurs propriétés primaires, mais aussi en tant que «symboles» objectifs porteurs d’information sémantique subjective.
En guise d’exemple, un livre peut être décrit selon ses propriétés physiques, mais il peut aussi être décrit selon son contenu, en fonction de son sens. Dans le premier cas, nous en avons une description kantienne dépourvue de sens, alors que dans le second cas, il prend valeur de symbole représentatif d’un contenu chargé de sens.
Dans son approche macroscopique à la mécanique quantique, Gomatam souligne l’importance des «propriétés relationnelles», qui se veulent la contrepartie objective d’attributs subjectifs. Fait intéressant, sa vision est tout à fait en accord avec la description de la matière que donne le sankhya védique. Elle ouvre ainsi la porte à un entendement de l’univers intégrant la science actuelle et une approche plus holistique où la conscience et d’autres phénomènes supranaturels font figure de catégories ontologiques au même titre que la matière.
Il en résulterait une sorte de philosophie fusionnelle en vertu de quoi les découvertes et les avancées modernes s’enrichiraient de notions ancestrales concernant la matière et la conscience pour donner naissance à une science plus ouverte à la réalité pluridimensionnelle de notre univers.
À suivre...