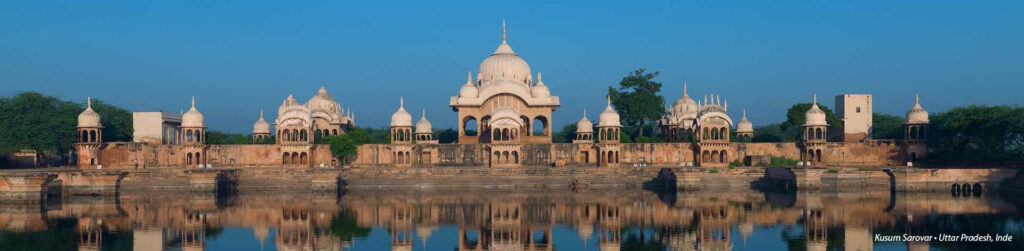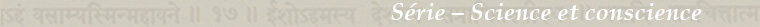

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Dans Consciousness: A Brief Insight, la parapsychologue Susan Blackmore écrit que 90% des gens dans le monde sont dualistes, se classant elle-même dans les 10% qui ne le sont pas. Les dualistes se définissent globalement comme étant d’avis que la conscience est d’une façon ou d’une autre distincte de leur cerveau et de leur corps, et qu’elle joue un rôle causal dans nos vies.
À ce compte-là, j’aurais tendance à dire que 100% des humains sont dualistes, y compris celle qui s’en défend. Il est en effet indéniable que dans notre vie de tous les jours, nos pensées conscientes influent sur nos activités physiques. Croire au contraire que la conscience et notre esprit sont faits de matière physique et qu’ils ne jouent aucun rôle causal dans nos vies ne peut qu’être qualifié de hautement irrationnel.
Pour les naturalistes et les physicalistes, le plus grand obstacle à l’admission de cette évidence tient sans doute à l’incapacité de la science à observer et évaluer de façon concluante le rôle causal de la conscience.
Par quel processus un phénomène immatériel et transnaturel influe-t-il sur le monde matériel et naturel? Comment la réalité subjective agit-elle sur la réalité objective?
Il est communément admis que la science a identifié les forces essentielles qui gouvernent le monde naturel – la force de gravitation, la force électromagnétique, les forces nucléaires faible et forte, etc. –, mais où se situe la conscience dans tout cela? La question est d’autant plus troublante lorsqu’on l’aborde sous l’angle de la physique classique, qui conçoit le monde comme un système fermé fonctionnant sans influence extérieure et dans lequel toutes les actions sont prédéterminées, ne laissant aucune place au libre arbitre.
Une prémisse douteuse
Cette conception du monde en vase clos sous-tend la notion de « clôture causale », qui nie toute influence possible d’une quelconque volition transcendant ses frontières, qu’il s’agisse d’une âme ou d’une entité divine.
Cette notion est cependant remise en question par la physique quantique, qui admet l’incertitude et les phénomènes aléatoires. Qui plus est, l’applicabilité universelle des lois de conservation – dont dépend la présomption de clôture causale – n’est elle-même qu’une hypothèse issue des sciences physiques. Il ne s’agit pas d’un fait en soi. Il n’existe d’ailleurs que peu ou pas de données à l’appui de la croyance que le corps d’un être vivant, plus particulièrement son cerveau, puisse être contraint à une quelconque forme de clôture causale.
Qu’il suffise de dire que l’hypothèse de la clôture causale, tenue pour être d’application universelle, dépasse de très loin ce que la science est en mesure de démontrer. Or, si rien ne prouve scientifiquement l’existence d’une clôture causale dans le corps ou le cerveau humain, rien ne justifie qu’on se fonde sur cette notion purement théorique pour rejeter la notion rigoureusement scientifique de causation immatérielle.
À la fois spectateurs et acteurs
Le physicien de renom Henry Stapp aborde la question relative à la conscience et au cerveau sous l’angle strictement orthodoxe de la mécanique quantique de von Neumann plutôt qu’à travers la lunette de la physique classique, et il affirme que la notion de clôture causale ne s’applique pas dans ce domaine. Plus précisément:
«La théorie physique contemporaine permet et, dans sa forme orthodoxe fidèle à van Neumann, suppose un dualisme interactif comparable à celui de Descartes.»
On ne saurait trop insister sur le fait que les fondations de la physique classique, sur lesquelles ont été élaborées les théories réductrices de la conscience, ont été complètement ébranlées par le virage quantique. Pour tout dire, l’intérêt des sciences pour la conscience est vraisemblablement issu de ce virage. Comme le souligne Stapp:
« Les fondateurs de la mécanique quantique ont posé un geste révolutionnaire en incorporant les expériences conscientes de l’humain en tant qu’élément fondamental de la théorie physique. Pour reprendre les mots de Niels Bohr, la principale innovation a été de reconnaître que “dans le grand drame de l’existence, nous sommes à la fois spectateurs et acteurs”. »
Ayant constaté que Stapp jouissait d’une notoriété peu commune auprès de ses pairs, j’étais curieux de savoir pourquoi. J’ai trouvé la réponse dans Irreducible Mind, d’Edward et Emily Kelly, qui en donnent deux principales raisons:
- contrairement à de nombreux auteurs populaires traitant de mécanique quantique, Stapp connaît la physique comme le fond de sa poche;
- il reste conservateur dans ses évocations de la théorie quantique, collant au plus près à ses fondements empiriquement prouvés et évitant de postuler quelque extrapolation exotique que ce soit.
J’ai pour ma part relevé qu’il avait en outre l’esprit particulièrement ouvert, allant jusqu’à publier un ouvrage sur les liens entre l’ontologie védique et la perspective scientifique contemporaine.
Quoi qu’il en soit, le modèle qu’il propose établit le rôle causal de la conscience en restant compatible avec toutes les lois de la physique, inclusion faite des lois de conservation de l’énergie. Il a su démontrer que la volition – une réalité immatérielle – pouvait théoriquement influencer le plan physique par sa capacité de sélection parmi les possibilités aléatoires qu’offre la mécanique quantique au sein la nature.
Sa théorie suggère que la conscience influe sur le plan physique en agissant de l’extérieur, et que son action s’opère en exploitant la part d’indéterminisme résiduel inhérent à la physique quantique. Stapp donne à ce modèle théorique le nom de «dualisme interactif quantique».
Scientifique sans être déterministe
L’exploit de Stapp et de ceux qui poursuivent leurs recherches dans le même sens est d’avoir réussi à secouer sérieusement les fondements scientifiques de la psychologie moniste et des neurosciences foncièrement matérialistes. Ce faisant, ils ont ouvert la porte à d’autres approches de nature dualiste et interactive de la conscience et de son lien avec le cerveau qui sont plus en accord avec la science fondamentale et notre expérience de la vie au quotidien. Stapp est ainsi parvenu à prouver qu’il est possible de voir le monde d’un œil rigoureusement scientifique sans pour autant être déterministe qui évacue l’impératif de clôture causale absolue et reconnaît l’intervention d’un agent actif.
Enfin, les travaux de Stapp et des autres promoteurs de l’approche quantique à la compréhension du monde soulignent le caractère dépassé de la vision mécaniste sur laquelle se fonde la physique classique. Au-delà de la conception newtonienne voulant que la matière soit composée d’éléments solides, nous savons maintenant que les objets que nous percevons sont tout sauf solides! De fait, le monde se révèle plus subjectif que la science n’aurait jusqu’ici pu l’imaginer.
À suivre...