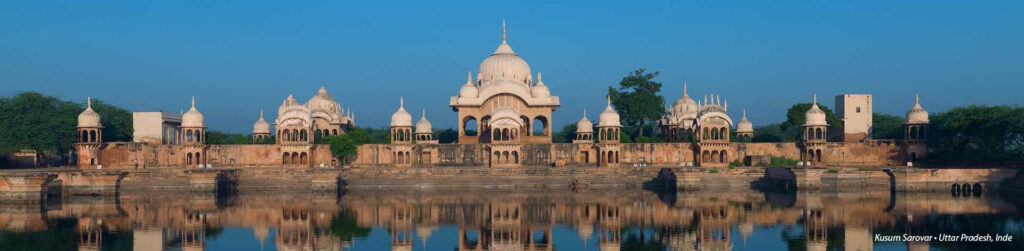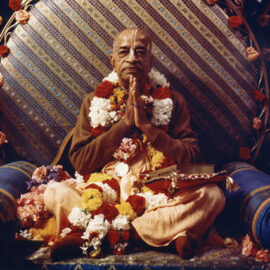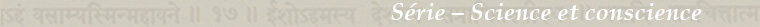

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Le philosophe et psychologue William James insistait sur la primauté de l’introspection et des témoignages à la première personne en ce qui concerne l’étude scientifique du mental et de la conscience. Cette approche a le mérite de souligner l’importance de l’expérience personnelle plutôt que de l’écarter comme le fait aujourd’hui une grande partie de la communauté scientifique.
Bien que les comptes rendus d’expériences contemplatives, par exemple, puissent sembler spéculatifs aux yeux et aux oreilles de personnes non familières avec ce genre d’expérience, ils n’en constituent pas moins un champ de recherche digne de retenir l’attention des plus sceptiques.
Il devient d’ailleurs de plus en plus courant d’admettre que la différence entre les méthodes d’étude subjectives et objectives tient davantage à leur niveau d’application qu’à leur nature propre. Et que la mise en veilleuse de l’introspection par les écoles de pensée occidentales tient davantage à l’ascendance du behaviorisme qu’à l’impertinence des témoignages à la première personne.
Tout bien considéré, il convient rationnellement d’envisager un élargissement de la perspective objective à la troisième personne de sorte à prendre en compte la méthode expérientielle à la première personne pour mieux comprendre la nature de la conscience.
Cette vision plus globale des choses nous rapproche de la notion de mysticisme évoquée, non sans surprise, dans le volet précédent, où matériel et immatériel se côtoient librement. Présent dans toutes les traditions philosophiques de la planète, le mysticisme se veut l’expression d’une expérience à proprement parler spirituelle au sein même du monde de la matière physique, par contraste avec une vision matériellement unidimensionnelle de la vie et de l’univers.
Identité pérenne
Dans la tradition védique, le mysticisme recouvre les notions de fonction essentielle (sanatana-dharma) et de savoir fondamental (tattva-jñāna). Il s’impose comme la science qui permet d’appréhender la réalité dans ses aspects pluridimensionnels, et il trouve son expression dans la pratique du yoga, dont le but consiste précisément à isoler la conscience du corps dans lequel elle se trouve. C’est ce qu’on appelle communément la réalisation de soi.
Par la pratique d’une discipline introspective à la première personne objectivement rigoureuse et éprouvée, le yogi apprend à se détacher des préoccupations matérielles et des distractions physiques pour focaliser sur son essence même. Non pas sur ses pensées ou ses désirs, qui relèvent de la matière psychique, mais bien sur sa conscience d’être.
Bien qu’il s’agisse là d’une expérience subjective, elle repose sur une approche systématique reconnue pour produire des résultats observables et reproductibles. D’où l’intérêt indéniable du mysticisme tel que conçu dans les Védas pour élargir la palette des outils de recherche de la science moderne. Bien que par des voies différentes, il permet en effet d’obtenir des résultats objectifs, de la nature même de ceux sur lesquels s’appuie la science actuelle, tout en partant d’expériences subjectives.
Pour ce qu’il en est plus précisément de la conscience, le mysticisme védique donne de réaliser concrètement que tout en étant présente dans un corps matériel évoluant dans le monde physique, elle n’en partage aucun attribut et ne dépend d’aucune de ses composantes.
À preuve, en état de sommeil profond – sans rêve –, les sens et le mental deviennent totalement inactifs. Pourtant au réveil, on se rappelle consciemment qu’on dormait.
On peut d’ailleurs à volonté et à tout moment se trouver à mille lieues de son corps, que ce soit en méditation, en rêve ou dans un moment de distraction, par exemple. La conscience peut en outre, dans certaines formes de yoga, conférer à ce même corps des pouvoirs à proprement parler surnaturels qu’il n’a par lui-même aucun moyen d’acquérir.
Bref, que ce soit en état de veille, en état de rêve ou en état de sommeil profond, voire d’anesthésie totale, l’être vivant conserve, à travers ces différents états, son identité propre et sa conscience d’exister dans un continuum en dépit de ses variations au gré des circonstances extérieures.
Place au mysticisme scientifique
Il en découle que la conscience est de nature essentiellement individuelle, puisqu’elle n’opère que dans un seul corps; personnelle, puisque l’expérience s’en veut exclusivement à la première personne; et spirituelle, puisque irréductible à quelque aspect que ce soit de la matière ou à quelque propriété que ce soit du monde physique.
Fait intéressant, les Védas vont jusqu’à préciser que l’être individuel, en soi pure conscience, peut, au contact de la matière, en venir à tout voir en termes de matière physique et de matière psychique, jusqu’à s’identifier littéralement au corps dans lequel il se trouve. Mais comme nous l’avons vu dans le troisième volet de cette série, cette conception altérée du soi, qu’on nomme le «faux ego», n’est que le reflet du véritable ego dépouillé des attaches illusoires qui le retiennent à la matière. Et de même que la réalité subjective du faux ego influe sur le comportement et les caractéristiques objectives de la matière environnante, le yoga permet au soi, au vrai moi, de retrouver son identité pure, débarrassée de sa conception matérielle de l’existence, en appliquant une méthode objective éprouvée de longue date.
Comme l’enseignait Bouddha et avant lui Krishna dans la Bhagavad-gita, de même que, bien avant encore, les Upanishads et les Puranas, l’altération de la conscience au contact de l’énergie matérielle et des mille attraits fugaces qu’elle fait miroiter devant nos yeux nous fait voir les choses pour ce qu’elles ne sont pas, ce qui est le propre de l’illusion. Si ce n’est que cette illusion toute subjective peut être dissipée par des pratiques expérientielles objectives propres à révéler la réalité pour ce qu’elle est vraiment.
Les pratiques en question amènent le yogi, qu’on qualifie aussi de spiritualiste, à maîtriser ses sens et son mental plutôt que de se laisser entraîner par eux dans un monde imaginaire qui le détourne constamment de son essence même. En démantelant ainsi ses biais cognitifs, sa conscience se voit proprement purifiée, et il acquiert une vision objective de lui-même et de tout ce qui l’entoure.
Tel est, selon les Védas, le pouvoir de ce qu’ils désignent du nom de mysticisme, dont les modalités sont on ne peut plus scientifiques bien que d’un tout autre ordre que les méthodes matérialistes et réductionnistes de la science d’inspiration occidentale.
À suivre...