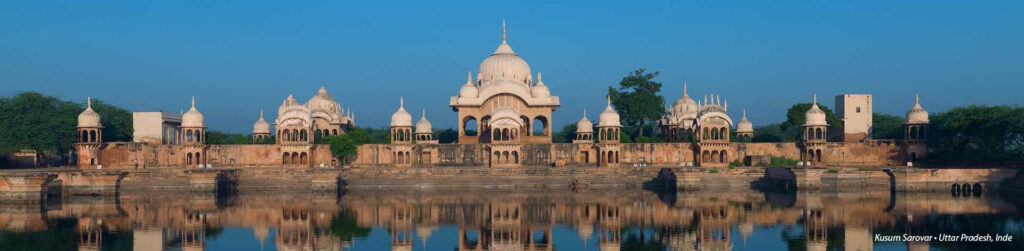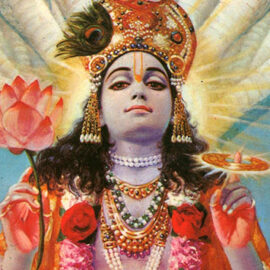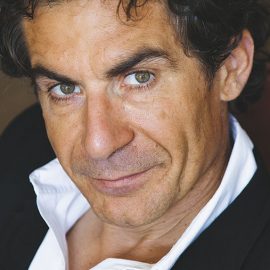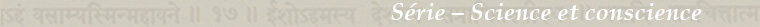

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Nombre de philosophes et de scientifiques se font les apôtres du naturalisme métaphysique en réduisant la conscience à un produit de la matière n’offrant en soi que peu d’intérêt. Cette école de pensée soutient que tout ce qui existe dans l’univers est de nature physique et peut être expliqué par des lois naturelles.
Une multitude de phénomènes dits «surnaturels», ou « paranormaux », abondamment documentés, contredisent toutefois cette théorie, et les raisonnements spéculatifs de ses défenseurs pour évincer ces phénomènes comme s’il ne s’agissait que d’illusions ou comme s’ils n’étaient que le fruit d’imaginations fertiles ou de cerveaux dérangés sont tout sauf concluants.
Sam Harris, un défenseur bien connu de la pensée scientifique, a d’ailleurs l’honnêteté de dire:
«L’idée selon laquelle la conscience émerge d’événements physiques inconscients ne m’apparaît pas comme étant proprement concevable. On peut toujours dire pompeusement que la conscience résulte du traitement inconscient de l’information enregistrée par le cerveau, tout comme on dirait que certains carrés peuvent être ronds, mais ces déclarations résultent-elles vraiment d’une analyse rationnelle approfondie de la question? J’en doute sérieusement.»
Le philosophe britannique Michael Lockwood livre quant à lui le témoignage qui suit:
«Permettez-moi d’abord d’afficher mes couleurs: je me considère comme un matérialiste, dans la mesure où je tiens la conscience pour une forme d’activité cérébrale. Cela dit, il m’apparaît évident qu’aucune description d’activité cérébrale pertinente, que ce soit en termes physiques, physiologiques, fonctionnels ou computationnels, n’arrive à cerner même de très loin le caractère distinctif de la conscience.
«Les lacunes de toutes les approches réductrices de la conscience sont si criantes que je n’arrive pas à imaginer que quiconque possède quelque notion de philosophie et jette un regard objectif sur les théories actuelles en la matière puisse les prendre au sérieux ne serait-ce qu’un instant, à moins de croire aveuglément que la science actuelle détient le monopole de la réalité et qu’il y a obligatoirement du vrai dans ce qu’elle avance de façon péremptoire faute d’en fournir la preuve.»
Une réalité suprasubjective
Il est en effet on ne peut plus évident qu’on risque fort de faire fausse route en s’acharnant à soutenir que la complexité de la conscience peut être réduite à la matière physique. Comme disait Whitehead dans La fonction de la raison, non sans une certaine pointe d’ironie:
«Les scientifiques animés par l’intention de prouver leur absence d’intention constituent un sujet d’étude intéressant.»
Il importe toutefois de se rappeler que tous les scientifiques ne soutiennent pas cette thèse. Nombre de chercheurs et de philosophes théistes et mystiques non moins sérieux que leurs homologues matérialistes s’entendent pour dire que la conscience ne saurait être ni physique ni psychique, et qu’il faut plutôt l’aborder sous l’angle d’une réalité suprasubjective.
Non seulement l’idée que la conscience n’est pas réductible à un phénomène physique est-elle universellement intuitive et relève-t-elle du gros bon sens, mais elle ne va à l’encontre d’aucune loi naturelle scientifiquement connue. Qui plus est, elle est conforme à d’autres hypothèses qui circulent au sein de la communauté scientifique, dont on sait très bien que tous les membres ne se rangent pas aveuglément du côté de la majorité. Et je ne vous apprends rien en vous disant que les écoles de pensée orientales abondent dans ce sens depuis toujours.
Les Védas soutiennent qu’il est illogique de nier que la conscience est d’essence causale. Autrement dit, non seulement elle n’est pas un produit passif de l’activité moléculaire, mais elle agit directement sur les processus physiques et psychiques dont elle est la cause primordiale.
Convictions et croyances
En philosophie, cette forme de négation est qualifiée de «contradiction performative», en ce qu’il s’agit d’une prise de position qui entre en contradiction avec le fait qu’on puisse l’énoncer. Dans le cas présent, le fait de nier le rôle causal de la conscience est fondamentalement contradictoire puisque pour nier quelque chose, il faut être conscient!
Le philosophe américain David Ray Griffin dégage trois présuppositions de sens commun à la base de nos convictions profondes, à savoir que:
- nous avons des expériences conscientes;
- nos expériences conscientes, bien qu’influencées par notre corps, ne sont pas entièrement déterminées par lui en ce qu’elles comportent une part d’autodétermination;
- nos expériences conscientes plus ou moins librement déterminées influent sur le comportement de notre corps, nous rendant plus ou moins responsables de nos gestes physiques.
Griffin définit nos convictions profondes comme étant distinctes de nos croyances circonstancielles en ce que nous ne pouvons les nier sans nous contredire. Alors que les croyances circonstancielles dépendent des sensibilités de chacun, et peuvent donc être niées sans risque de se dédire, les convictions profondes sont universelles dans la société humaine, que notre vision du monde soit matérialiste ou spirituelle.
Cette distinction est lourde de sens dans la mesure où une vision du monde qui nie les convictions profondes universellement admises n’est pas seulement illogique, elle relativise toute notion de moralité et nous dégage de toute responsabilité à l’égard de nos actes, bons ou mauvais. Elle rend en outre nos propos aussi futiles et vides de sens que les gouttes de pluie qui tombent sur un rocher.
Griffin n’a fait que constater, après des années d’étude, que les trois convictions profondes mises en lumière font partie des présuppositions communes à tous les humains, de sorte qu’en nier la validité est en soi paradoxal et contradictoire. On ne peut affirmer implicitement quelque chose qu’on nie explicitement, comme «Je ne dis jamais la vérité.»
Ce qu’il convient de retenir à ce stade, c’est que ces trois convictions profondes sont vieilles comme le monde, et qu’au contraire de croyances anciennes déboulonnées au fil des siècles, il ne s’agit pas de simples superstitions.
Aussi le philosophe déplore-t-il qu’autant de naturalistes et de matérialistes, y compris en neurosciences, soutiennent avec vigueur d’obscures théories réductrices de la conscience alors qu’elles sont contre-intuitives, irrationnelles et contraires au sens commun. Un moule apparemment difficile à briser de nos jours!
À suivre...