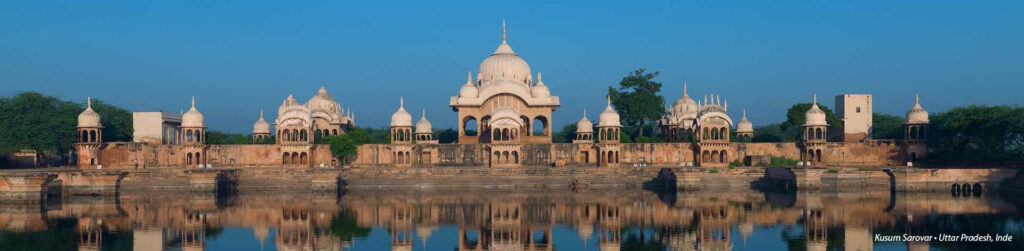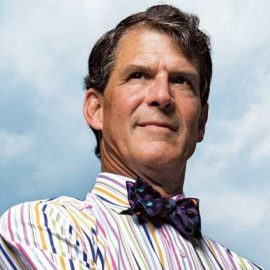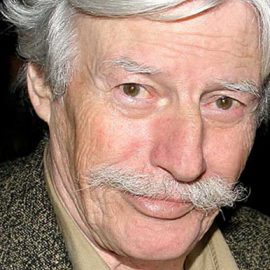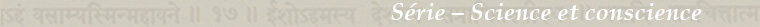

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Jusqu’ici, je m’en suis essentiellement tenu aux positions de la science moderne concernant la question qui nous occupe, et il en ressort – comme l’ont eux-mêmes souligné nombre de scientifiques de renom – que, dans sa forme actuelle et en dépit de ses promesses, la science échoue lamentablement à réduire la conscience à une propriété émergente de la matière. Non seulement sa proposition va à l’encontre du sens commun, mais elle n’a aucun moyen de prouver même sommairement ce qu’elle avance.
Il n’y a cependant aucune raison d’en rester à cette impasse. Une vision du monde intégrant la matière et la conscience comme deux réalités distinctes en interaction n’a en effet rien de déraisonnable ni d’incompatible avec une démarche rigoureusement scientifique. Elle nécessite toutefois un élargissement des cadres de la science actuelle, car force est de reconnaître que non seulement la conscience, mais nombre de phénomènes et de manifestations du vivant – par opposition à la matière inerte – qui échappent à nos instruments d’observation et de mesure la dépassent complètement.
Un premier pas dans cette direction se veut franchi par l’avènement de théories aussi bien quantiques que non quantiques qui attribuent un rôle actif à la conscience. Ces théories ont bien entendu leurs détracteurs, mais il en est de même de toutes les théories qui réduisent la conscience à un produit de la matière, qu’elles relèvent de la philosophie, de la neurophysiologie, de la psychotropie, de l’introspectionisme, de la psychanalyse, de la psychologie cognitive, de la science informatique, de la mécanique quantique ou de la biologie évolutive.
Un changement de perspective s’impose
S’il est vrai qu’il demeure impossible de démontrer de façon concluante à la satisfaction de tous que la conscience joue un rôle causal bien qu’elle soit immatérielle, il convient de se rappeler qu’en matière d’observation et de mesure, notre capacité à démontrer objectivement ce que nous percevons subjectivement reste limitée.
À titre d’exemple, nous sommes incapables de démontrer objectivement que nous existons sur la base de notre expérience subjective d’exister. Ainsi, bien qu’elle soit subjective, notre expérience du fait que nous existons est la seule et unique chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer à cet égard.
Cela dit, comme nous l’avons vu dans le quatrième volet de cette série, nous disposons aujourd’hui d’arguments scientifiques – qui, faute d’être concluants, n’en sont pas moins crédibles – à l’appui de la nature causale de la conscience, autrement dit de ce que la réalité subjective influe sur la réalité objective.
Quoi qu’il en soit, les recherches multidisciplinaires des dernières décennies ont complètement révolutionné notre compréhension de la matière, et la science cherche encore à s’y adapter, tout en amorçant timidement l’étude de la conscience pour tenter de combler les écarts. Sa démarche se voit néanmoins freinée par les limites que lui imposent ses contraintes actuelles, d’où l’importance, encore une fois, d’élargir ses cadres.
Compte tenu des limites de la physique quantique énoncées dans les volets deux et quatre, les théories qui en émanent ne suffisent pas à combler les lacunes de la science en ce qui concerne l’étude de la conscience, mais elles ouvrent tout de même la porte à de nouvelles façons d’aborder la question, comme en témoignent les travaux d’une nouvelle vague de chercheurs, parmi lesquels Ravi V. Gomatam, dont j’exposais l’approche dans le volet précédent.
Place à la subjectivité objective
Rappelons-nous que la science moderne est née du christianisme, qu’elle est devenue agnostique dans son adolescence, et que, parvenue à l’âge adulte, elle est dorénavant largement athée. Or, d’aucuns sont d’avis que si elle veut atteindre sa pleine maturité dans la sagesse, elle a tout intérêt à embrasser le mysticisme! Les traditions dites «mystiques», qui conjuguent le matériel et l’immatériel, nous livrent en effet des données observables qui, bien que largement inconnues, incomprises ou mésinterprétées, gagnent à être prises en considération. Une approche que Tripurari Swami qualifie de «subjectivité objective».
La science reconnaît déjà la réalité subjective de l’état expérientiel, mais elle rejette largement la notion connexe voulant que l’état expérientiel soit le fait d’une entité à part entière, d’un «soi» constitué de matière psychique ou de l’essence même de la conscience. Un rejet qui semble pour le moins arbitraire, sinon déraisonnable.
Il est en effet entendu que l’être humain appréhende certains faits objectifs sur la seule base de son expérience subjective. Or, si nous avons objectivement connaissance de vivre des expériences subjectives, pourquoi n’aurions-nous pas aussi connaissance d’être des entités à part entière dotées d’une certaine part de libre arbitre, comme le suggère notre expérience subjective?
Pourquoi donc la science accepterait-elle l’existence de l’expérience subjective et nierait-elle celle de l’auteur de cette expérience? Puisque l’état expérientiel est tenu pour subjectif, est-il plus raisonnable de croire que l’expérience subjective crée aléatoirement l’illusion d’un soi individuel, ou qu’elle est elle-même le fait d’un soi individuel et immatériel?
Ces questions n’ont rien de banal, et elles nous incitent fortement à poursuivre notre exploration du lien entre le subjectif et l’objectif, ainsi que du mystérieux phénomène de la conscience, qui semble de plus en plus participer de l’un comme de l’autre.
À suivre...